Brice Molo
Home - About - Team - News - Publications - Joschka Philipps - Gallery
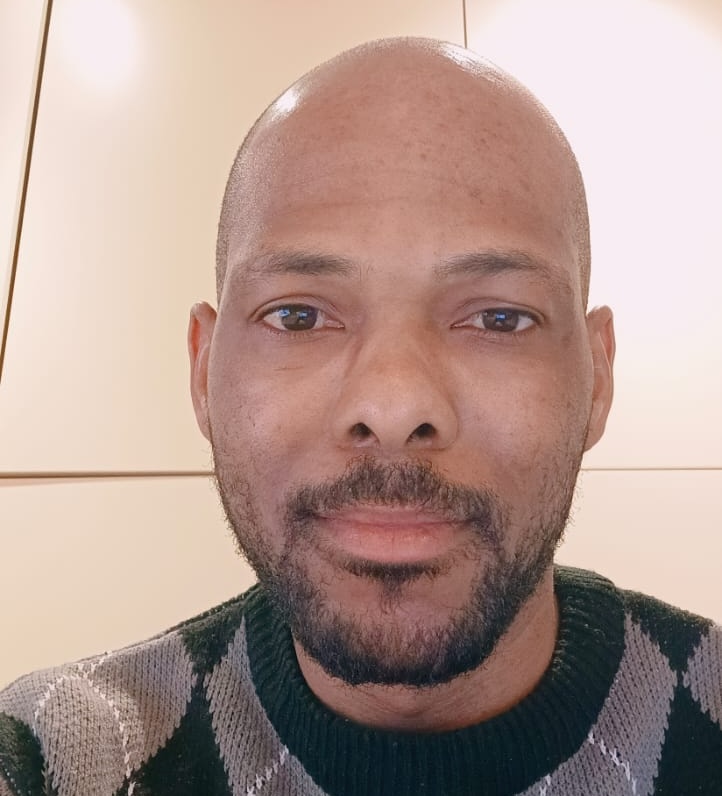
Personal Information
Brice Molo has a PhD in sociology (EHESS) and history (University of Yaoundé I). His work focuses on the management of risks, disasters and mass deaths in Cameroon, on dissidence and images of witchcraft in a postcolonial context. He is the winner of the 2023 EHESS Dissertation Prize and a member of the Executive Committee of the French Sociological Association. He teaches Sociology of Violence and Protest at the Catholic Institute in Paris, co-organizes the monthly seminar of the African Studies Association at the Quai Branly-Jacques Chirac Museum, and coordinates the Africa program at Noria-Research.
Etat, sorciers et catastrophes. Imaginaires politiques et politiques de l’imaginaire au Cameroun postcolonial
Résumé
La sorcellerie constitue l’un des cadres d’analyse et une des grilles d’interprétation les plus répandus au Cameroun en situation de mort collective. Que l’événement émane de négligences des pouvoirs publics, d’abandon de l’État ou d’inconduite des catégories sociales les plus vulnérables, le recours aux imaginaires sorcellaires sert chaque fois à établir les responsabilités, confondre le coupable et bouc émissaire, réparer le malheur et formuler des demandes de réparations. À partir de deux situations de catastrophes anthropiques survenues au Cameroun, ce chapitre veut interroger la performativité des imaginaires sorcellaires au Cameroun, la circularité des rumeurs, les processus politiques qui les fondent et les renforcent, les économies symboliques de la justice qu’ils renferment et les dispositifs de mise en accusation qui les sous-tendent.
Le 14 février 1998, à midi, sous un soleil accablant de saison sèche, un violent incendie se déclenche au quartier populaire Nsam à Yaoundé, entraînant la mort de plus de 300 personnes. La plus importante catastrophe anthropique au Cameroun vient de se produire, et une partie de l’opinion nationale désigne son coupable. Il s’agit pour elle de la mal gouvernance et l’abandon des pouvoirs publics. Comment un important commerce illicite de produits pétroliers a-t-il pu prospérer dans un quartier aussi paupérisé à quelques minutes du centre-ville de la capitale politique, et pourquoi les autorités n’ont-elles pas agi plus tôt alors que, depuis l’aube, s’écoulent plus de 200 000 litres d’essence sans intervention des forces publiques, sinon avec leur concussion ? De leur côté, les autorités désignent un coupable idéal, les voleurs de carburant de Nsam, pourtant principales victimes de l’incendie. Pour la ministre des Affaires sociales, les brûlés sont responsables de leur propre malheur en puisant un carburant qui ne leur appartenait pas. En tentant de patrimonialiser un bien public, ils ne mériteraient ni reconnaissance publique, ni réparations, ni le statut de morts dignes de la République. Cette position de la ministre était favorisée par l’absence du président Paul Biya, ainsi que par la crainte des familles des victimes face aux représailles d’un régime autoritaire. Cependant, dès le retour du président camerounais, celui-ci déclare dans une interview que le rapport à l’État est en question, que les victimes doivent être immédiatement prises en charge aux frais de l’État, et qu’une commission d’enquête établira les responsabilités. Cette prise de position marque un revirement pour la ministre des Affaires sociales, qui reconnaît désormais la précarité des victimes. Cherchant de nouveaux boucs émissaires, elle adhère aux discours de certains riverains accusant les sorciers d’avoir « vendu et mangé les victimes dans la sorcellerie » et sacrifié toute une génération du quartier. Les imaginaires sorcellaires deviennent un dispositif de déresponsabilisation du gouvernement dans la survenue de la catastrophe, offrent à certains riverains un moyen de détourner les accusations de mauvais citoyens et voleurs. À Nsam, ces imaginaires permettent aux autorités de négocier une sortie de crise, tandis qu’ils permettent aux riverains d’attribuer les responsabilités à d’autres catégories sociales indésirables (les sorciers du quartier) et de négocier leur condition de victimes, pour ouvrir la voie à des réparations. Si à Nsam, la portée des imaginaires sorcellaires est si importante dans la gestion in itinere et post catastrophe, à Eséka, ils accompagnent la catastrophe, permettent de l’articuler, s’y insèrent et la font advenir, au-delà des simples logiques de mise en accusation.
En effet, le train qui déraille le 21 octobre 2016, tuant plus de 80 personnes à Eséka, dans la région du centre au Cameroun, est présenté longtemps avant la catastrophe comme un train zombie, ensorcelé par les Bassas qui demandent qu’il s’arrête dans les gares de leur département pour respecter le sacrifice des ancêtres qui ont travaillé en période coloniale allemande puis française à construire le chemin de fer. Lorsque la catastrophe survient, la sorcellerie devient un discours de pouvoir et un discours sur le pouvoir de cette manière dissimulée d’agir pour réparer une injustice subie par toute une communauté. Cette fois, les autorités s’en servent pour confondre l’entreprise CAMRAIL dont le capital majoritaire est détenu par un industriel français, Vincent Bolloré. La CAMRAIL est condamnée à réparer la catastrophe pour sa responsabilité dans la prise de décision d’ajout des wagons sans contrôle du système de freinage du train, ce qu’un rapport d’une commission internationale établit quelques mois plus tard. Là où les causes identifiées par la commission internationale permettent aux autorités de se déresponsabiliser aux yeux de l’opinion internationale, la sorcellerie leur sert à se départir des accusations d’une partie de l’opinion nationale et locale ésékaienne qui y adhéraient déjà. Par ailleurs, la CAMRAIL utilise cette même sorcellerie pour nier sa responsabilité, accusant les riverains d’avoir ensorcelé le train et provoqué la catastrophe dans leur propre ville.
Au-delà de cette bouc-émissarisation, la catastrophe offre aux autorités un alibi commode pour renégocier avec les populations locales les politiques du train, conformément à leurs revendications et confirme la performativité des imaginaires sorcellaires. Ces imaginaires permettent aussi d’observer comment une pratique considérée comme néfaste au sein d’une communauté et comme un délit par les pouvoirs publics – la sorcellerie étant condamnée par le code pénal camerounais – sort du cadre de l’illégitimité et de la réprobation sociale pour devenir un dispositif de participation politique dont la validité est reconnue. C’est parce que la sorcellerie vient réparer ce qui est considéré localement comme une colère légitime qu’elle devient une forme d’économie symbolique de la justice, dont le recours permet de négocier la reconnaissance des torts et la redistribution des réparations. Cette validité, réévaluée et rendue acceptable par les rumeurs et représentations post-catastrophe, résulte de la capacité de l’événement à résoudre un problème. La sorcellerie est alors présentée comme une modalité de sanction de l’État et de la CAMRAIL, de mise sur agenda d’un problème, et de négociation pour la réinsertion du département dans l’itinéraire du train.
Ce chapitre questionne dès lors, la place de la sorcellerie dans une telle société. Elle explore la catégorie de « l’Etat sorcier » proposé par Bernard Hours qui en propose un usage métaphorique. Celui-ci permet de décrire la situation précaire des médecins qui se trouvent au centre d’accusations à la fois des autorités et des patients. Les premiers les considérant comme de mauvais fonctionnaires qui effectuent mal leur travail et ternissent l’image de l’Etat auprès des patients. Ces derniers les considérant comme des fonctionnaires malhonnêtes à qui peuvent être imputés la non-guérison des patients, l’insuffisance des soins, des médicaments et du plateau technique. En allant au-delà du métaphorique, ce chapitre réinvestit cette catégorie de l’Etat sorcier pour lui trouver une portée analytique nouvelle face à la catastrophe et la manière dont elle est resignifiée par les acteurs à la fois du haut et du bas, pour donner à la sorcellerie une place centrale dans la résolution des problèmes et crises qui traversent la société camerounaise postcoloniale.
Biographie de l’auteur
Brice Molo has is a doctor of sociology (EHESS) and history (University of Yaoundé I). His work focuses on the government of risks, disasters and collective death in Cameroon, dissidence, and witchcraft imagery in a post-colonial context. Winner of the 2023 EHESS dissertation prize, he is a member of the executive committee of the French Sociological Association; he teaches the sociology of violence and protest at the Catholic Institute of Paris, co-organizes the monthly seminar of the Africanists' Society at the Quai Branly- Jacques Chirac Museum and coordinates the Africa program at Noria-Research.

